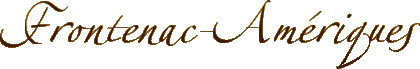L’acte de naissance de la littérature de langue française des Premières Nations du Québec peut être situé au début des années soixante-dix du siècle dernier et, au cours des deux dernières décennies, cette autre facette de la francophonie canadienne est en train d’expérimenter une effervescence sans précédent, grâce aussi à l’intérêt de maisons d’édition comme Mémoire d’encrier, qui promeuvent et soutiennent la production littéraire des auteurs autochtones du Québec.
L’acte de naissance de la littérature de langue française des Premières Nations du Québec peut être situé au début des années soixante-dix du siècle dernier et, au cours des deux dernières décennies, cette autre facette de la francophonie canadienne est en train d’expérimenter une effervescence sans précédent, grâce aussi à l’intérêt de maisons d’édition comme Mémoire d’encrier, qui promeuvent et soutiennent la production littéraire des auteurs autochtones du Québec.
Je vais chercher à tracer rapidement l’évolution de cette jeune littérature, en proposant des réflexions sur l’un des stéréotypes qui colle depuis toujours aux peuples autochtones, leur proximité avec l’état de nature – ce qui justifiait l’appellation de Sauvages, sans intention péjorative d’ailleurs, qu’on leur donnait au début de la colonisation française au dix-septième et dix-huitième siècles, une identification basée sur l’opposition entre nature et culture, bien nourrie, depuis Rousseau, de fondements philosophiques et scientifiques divers.
Dans la première partie de cet exposé, je vais présenter la théorie d’après laquelle pour les Amérindiens la nature est culture, et dans la seconde partie je vais proposer une lecture de l’évolution de l’imaginaire de la nature chez des écrivains et écrivaines autochtones appartenant à des générations différentes.
L’historien Georges E. Sioui, de la nation huron-wendat, dans son essai Pour une histoire amérindienne de l’Amérique publié en 1999, introduit la notion d’« autohistoire (1) » pour déplacer à l’intérieur de la perspective amérindienne le point de vue sur l’histoire des Amérindiens, qui jusque-là n’avait été racontée que par les Blancs.
Afin de bien faire comprendre leur évolution historique et culturelle, Sioui se réclame de la vision amérindienne du Cercle sacré de la vie et de l’univers, fondée sur le rapport à la Terre et sur l’observation des aspects cycliques et circulaires de la réalité naturelle : « la réalité du Cercle sacré de la vie, dans lequel tous les êtres, matériels et immatériels, sont égaux et interdépendants » (Sioui 14).
Cette vision l’amène à tenir des propos qui peuvent paraître étonnants aux oreilles d’un Blanc occidental. Cet essai fondateur de l’historiographie amérindienne au Québec, tout en s’appuyant sur de solides bases philosophiques et scientifiques, pose des affirmations qui d’emblée ne sauraient être définies autrement que carrément irréalistes ou, à la rigueur, utopiques. Face à la catastrophe démographique, à la dépossession de leurs territoires et au bouleversement de leurs modes de vie qui ont affecté les Amérindiens depuis le contact avec les Blancs, la première des prémisses de l’approche méthodologique adoptée par Sioui pourrait bien laisser de prime abord perplexe :
| […] en dépit du mode d’appropriation du territoire par les Européens, les valeurs culturelles de l’Amérindien ont davantage influencé la formation du caractère de l’Euro-Américain que les valeurs de ce dernier n’ont modifié le code culturel de l’Amérindien, puisque ce dernier n’a pas quitté son milieu naturel (Sioui 31). |
Il cite les mots révélateurs d’un sage et ancien chef de la nation innue : « Quant à la persistance de la culture amérindienne, Raphaël affirme que “l’Indien continuera toujours de s’identifier comme Indien. […] En un mot, tant que l’Indien sera en (sic) Canada, il restera Indien : ça ne changera pas” » (Sioui 45).
Il pose donc sa certitude de la persistance des valeurs amérindiennes (36) et de la vigueur de la conscience amérindienne (43) sur le lien ininterrompu que les Amérindiens entretiennent depuis toujours avec leurs territoires et leur environnement naturel. La philosophie du Cercle permet d’éclaircir la valeur essentielle de ces affirmations qui semblent pencher du côté de l’utopie et de déjouer, par la même occasion, certains clichés qui renvoient une image faussée des Amérindiens et de leurs civilisations. Sous la plume de Sioui, la théorie scientifique de l’évolution se tourne en mythe de l’évolution (2), dont découle le mythe de la disparition de l’autochtone (2) :
| Cet anéantissement serait la conséquence logique et normale du choc qui se produit entre une civilisation très “avancée” et une autre – en particulier celle des autochtones du Nouveau Monde – très “retardée”. […] C’est le Cercle sacré de la vie qui s’oppose à la conception évolutionniste du monde selon laquelle les êtres sont inégaux, souvent méconnus, constamment bousculés et remplacés par d’autres qui semblent adaptés à l’“évolution” (Sioui 2-3). |
À l’opposé de la conception euro-américaine du temps et de l’évolution procédant en ligne droite, la vision du Cercle propose une idée alternative du progrès des civilisations, qui épouse le mouvement des cycles naturels, et se veut le fondement philosophique de la confiance des Amérindiens dans la persistance de leurs cultures, malgré la décimation de la population autochtone et les changements bouleversants qui les ont affectés au cours des siècles :
| La grande majorité des nations amérindiennes entretiennent la croyance ferme que le progrès, tel que l’entendent les civilisations dominantes, qui fait de l’homme un seigneur déconscientisé de la création, aura un jour une fin et que l’Amérindien aura alors la responsabilité de retransmettre aux autres peuples de la terre un mode social basé sur la compréhension du Cercle (Sioui 41). |
Ces propos de Sioui, qui devaient paraître utopiques à l’époque de l’écriture et de la publication de son essai, 35 ans après s’avèrent prophétiques de la nouvelle conscience écologique de plus en plus répandue parmi les jeunes générations :
| Nous sommes probablement le people le plus uni au monde. Nous possédons l’unité spirituelle, car nous comprenons tous la signification du Cercle. Et ce qui accroît davantage notre espoir est que de nombreux “non-autochtones” nous rejoignent chaque jour dans notre croyance au Cercle. Par conséquent nos effectifs ne sont pas en train de s’amoindrir, comme plusieurs le pensent encore, mais bien en train de s’amplifier. Et ça c’est notre secret. (Sioui X) |
L’imaginaire amérindien de la nature demeure donc la preuve « […] que la grandeur amérindienne n’est pas qu’un vestige du passé : l’avenir permettra aux autochtones de jouer un rôle très important en fournissant à l’Amérique du Nord et au reste du monde un modèle de société viable » (Trigger xi).
La représentation de la nature et de l’imaginaire naturel demeure donc l’aspect culturel fondamental de la littérature des Premières Nations du Québec depuis les écrits de Bernard Assiniwi, l’écrivain québécois de souche algonquine et crie, considéré comme le pionnier de la littérature amérindienne de langue française. Son roman historique La saga des Béothuks, qu’il a écrit à la suite de longues recherches sur l’île de Terre-Neuve où la nation béothuke demeura jusqu’à sa complète extinction en 1829, reflète la vision amérindienne du Cercle sacré.
La Saga prend l’essor de l’exploration initiatique qu’Anin, le fondateur mythique de la nation des Béothuks, entreprend pour découvrir « si cette terre était ronde, si c’était une île ou si ce n’était qu’une longue bande de terre qui s’avance dans la mer » (Assiniwi 46). La connaissance du territoire, la conception du Cercle à la base de la réalité environnante, la valeur de la transmission de la mémoire culturelle sont autant de fondements de la civilisation amérindienne destinés à devenir des topoï de la littérature autochtone :
| Si l’aïeul avait raison, la terre faite par le castor et à l’image de sa maison ne pouvait être que ronde. Le mâle ayant fait sa cabane au-dessus et la femelle au-dessous et à l’envers, la terre avait grossi entre les deux cabanes. Depuis lors le monde est rond, soutenu par les souffles du vent dans l’immensité des esprits. En suivant les contours de la terre ferme, il était évident pour Anin qu’on revenait à la même place (Assiniwi 13). |
L’attention au territoire et au milieu naturel dans La saga des Béothuks se manifeste surtout par la référence constante à l’espace géographique, par la carte de l’île de Terre-Neuve placée au début de chacune des trois parties composant le roman, par l’attention aux changements des toponymes reflétant l’appropriation progressive de territoires des Béothuks par les Européens. Le roman d’Assiniwi se place donc sous le signe de la perte – du territoire, du peuple, de la culture, du langage – mais ce n’est que d’après le point de vue des Blancs, puisque la perspective des Béothuks demeure ancrée dans la certitude de l’éternité des valeurs amérindiennes dont parle Sioui :
| Il faut […] toujours avoir les oreilles propres pour entendre et les yeux ouverts pour voir et comprendre. Voilà le secret de l’existence des Béothuks. C’est pourquoi […] les Béothuks vivraient toujours, même quand mourrait le dernier. Ils continueraient de vivre en d’autres. Dans d’autres mémoires. Dans d’autres apprentissages. […] les Béothuks étaient éternels. Ils étaient la vie. [...] Les Béothuks étaient “les vrais hommes”. Les vrais hommes ont toujours des choses à apprendre. Ils sont éternels par leur besoin de savoir, de connaître, de donner » (Assiniwi 281) |
Dans la littérature amérindienne, la célébration du passé et la confiance dans l’avenir ne relèvent donc pas d’une attitude utopique, dans le sens courant ou littéraire du mot, mais elles ressortissent au topos, dans son sens étymologique de lieu physique, et dans sa valeur littéraire de motif récurrent. Cette « écologie » particulière de l’histoire et de l’écriture amérindienne se fait d’autant plus évidente dans les textes de l’extrême contemporain dont les auteurs deviennent de plus en plus conscients du rôle qu’ils sont appelés à jouer en tant que porte-parole d’instances culturelles. Le nouveau rapport au territoire, entraîné par le passage du nomadisme à la sédentarisation, a évidemment impliqué une redéfinition identitaire :
| Aujourd’hui […] sans doute à cause de leur dépossession territoriale, cette identification s’est orientée de façon exacerbée vers les réserves. Les Amérindiens semblent devoir appartenir d’abord à une réserve déterminée et ensuite à un territoire. […] La réserve est devenue aujourd’hui, pour plusieurs Amérindiens, le lieu d’affirmation identitaire où se conserve la culture originelle, non contaminée. D’autres, plus nombreux, affirment pourtant que ce lieu n’est pas la réserve, mais la forêt » (Gatti 2006 : 119-120). |
Dans le roman Kuessipan de la jeune écrivaine innue Naomi Fontaine, ce nouveau rapport au territoire est bien illustré et il semble conjuguer les deux attitudes. La représentation de la vie dans la réserve de Uashat, sur la côte nord du fleuve Saint-Laurent, ne néglige pas l’identification détaillée des lieux jusqu’à la succession des noms des rues : « Les maisons, elles, se cordent et s’imitent. Un minuscule village appelé réserve. Des rues. Pashin. De Queen. Grégoire. Arnaud. Kamin. Il y a du sable sur le devant des maisons. Sur l’asphalte des rues » (Fontaine 34). D’ailleurs, le territoire ancestral, le Nutshimit, demeure le lieu de l’identité véritable et originaire, malgré l’extinction des anciennes coutumes nomades et les nouveaux modes d’appropriation du territoire :
| Nutshimit, c’est l’intérieur des terres, celles de mes ancêtres. Chaque famille connaît ses terres. Les lacs servent de route. Les rivières indiquent le nord. Si on s’aventure trop loin, par manque de jugement, il y a toujours le chemin de fer pour retrouver sa voie. Nutshimit, un rituel pour les chasseurs de caribous. Un air pur dont les vieux ne peuvent pas se passer. Depuis qu’ils ont perdu la vigueur de leurs jambes, ils y vont pour respirer. Nutshimit, un terrain inconnu, mais non hostile pour celui qui y cherche le repos de l’esprit. Autrefois, ces forêts étaient habitées par des hommes, des femmes qui prenaient de leurs mains ce que la Terre leur offrait. Ils n’y sont plus, mais ils ont laissé sur les rochers, l’eau des chutes et le vert des épinettes, leur empreinte, leur regard. Nutshimit, pour l’homme confus, c’est la paix. Cette paix intérieure qu’il recherche désespérément (Fontaine 65). |
Dans les textes poétiques de Joséphine Bacon, Rita Mestokosho, Natasha Kanapé Fontaine, pour ne citer que trois écrivaines, représentant trois générations différentes, parmi les auteurs qui occupent aujourd’hui le devant de la scène littéraire amérindienne au Québec, le territoire est porteur de signes, de significations, de langage et il se place donc à l’origine de l’écriture littéraire :
| Les arbres ont parlé avant les hommes. Tshissinuatshitakana, les bâtons à message, servaient de points de repère à mes grands-parents dans le nutshimit, à l’intérieur des terres. Les Innus laissaient ces messages visuels sur leur chemin pour informer les autres nomades de leur situation. […] À travers eux, la parole était toujours en voyage (Bacon 7). |
La même superposition de l’écriture au territoire et au caractère identitaire nomade est convoquée par Rita Mestokosho :
| Mon peuple écrivait en marchant Mon peuple écrivait sur la ligne de la mémoire De cette façon son bagage était moins lourd Car il avait une immense bibliothèque avec lui Des millions de livres, Éparpillés sur le territoire innu Des encyclopédies de rivières Des dictionnaires de montagnes Des géographies de forêts Chaque ligne qu’il écrivait Était pour garder sa mémoire éveillée Son esprit vif et son cœur léger (Mestokosho 54) |
Du point de vue de nombreux auteurs autochtones, la littérature se voit donc convoquée pour donner sens à l’histoire individuelle et collective, renouveler les formes culturelles et imaginer un avenir qui soit en continuité avec le passé et cela à partir du territoire et de l’environnement naturel.
La poète-slameuse Natasha Kanapé Fontaine, appartenant à la jeune génération de poètes innues, parvient à conjuguer dans son recueil de poèmes Manifeste Assi – « Assi en innu veut dire Terre » (5) – l’appartenance au territoire, la pérennité de la tradition, et le renouvellement de la forme poétique qui se veut un chant d’amour pour la Terre au même temps qu’un manifeste militant pour la cause amérindienne et une déclaration d’identité individuelle et collective :
| Assi en innu veut dire Terre. Au départ, il n’y a qu’elle. Son ventre et son royaume. Sa cosmogonie du règne animal et végétal. Les arbres, les eaux, les loups et les hordes de caribous. Puis il y a le peuple. Les Innus. Il y a moi. Forte d’un nouvel éveil. […] Les esprits, eux, dansent. Ils dansent sur le pays. Je reçois leurs visions. Dites-moi, aujourd’hui, qui croit aux prophéties ? Je viens de cette lignée. De la lignée des chasseurs et des braves. Je suis la fille de ceux qui marchaient dans les rêves. La petite-fille des shamans et des guérisseurs. La sœur de ceux qui parlent aux ancêtres. […] Alors, puisque je suis ici à embrasser le sol de ma terre, Assi, je libérerai ses chants de femme. (Kanapé Fontaine 6-7) |
Par ce bref survol, quoique trop rapide et incomplet, de la littérature amérindienne au Québec, j’espère en avoir mis en évidence les signes de sa maturation progressive. Aujourd’hui c’est par l’évolution de la valeur du lieu dans les textes qu’on peut mesurer l’évolution de cette littérature : le territoire n’est pas que l’objet de l’écriture en tant que lieu physique, mais aussi bien le sujet de l’énonciation générateur de formes et styles nouveaux en tant que topos littéraire marquant désormais plusieurs générations d’écrivains. Ses significations ne prêtent plus à confusion sur la place qu’il occupe dans le contexte littéraire, même si un classement des genres fondé sur des assises issues de sources autochtones reste encore à définir. Il est évident que le territoire, en tant que lieu physique et symbolique, lieu de la Terre et de l’imaginaire, est appelé à jouer un rôle majeur même dans un discours critique fondé sur des assises amérindiennes :
| Pour un développement positif de l’histoire et des sciences en général (humaines et autres), l’écologie doit devenir la mère commune de toutes les sciences et l’histoire, comme toutes les sciences sociales, doit considérer la dimension écologique comme fondamentale. Le but universel doit être le bien-être écologique commun. (Sioui 134-135). |
Et pour nos débats de la plus stricte actualité, il semble bien que les Premières Nations ont bien des choses à nous apprendre !
Angela Buono
Université de Naples « L’Orientale »
(1) Cette notion apparaissait dès le titre de la première édition de l’essai de Georges E. Sioui, Pour une autohistoire amérindienne : Essai sur les fondements d’une morale sociale, Québec, Les Presses de l’Université Laval, 1989.
Bibliographie
Assiniwi, Bernard, La Saga des Béothuks, Montréal / Arles, Leméac / Actes Sud, 1996.
Bacon, Joséphine, Bâtons à message / Tshissinuatshitakana, Montréal, Mémoire d’encrier, 2009.
Fontaine, Naomi, Kuessipan. À toi, Montréal, Mémoire d’encrier, 2011.
Gatti, Maurizio, Être auteur autochtone au Québec aujourd’hui, in Robert Viau (éd.), La création littéraire dans le contexte de l’exiguïté, Saint-Nicolas (Québec), Publications MNH, 2000, p. 183-194.
Gatti, Maurizio, Être écrivain amérindien au Québec. Indianité et création littéraire, Montréal, Éditions Hurtubise HMH, 2006.
Gatti, Maurizio, « La Saga de Bernard Assiniwi, ou comment faire revivre les Béothuks », International Journal of Canadian Studies / Revue internationale d’études canadiennes, 41 (2010), p. 279-296.
Kanapé Fontaine, Natasha, Manifeste Assi, Montréal, Mémoire d’encrier, 2014.
Mestokosho, Rita, Eshi Uapataman Nukum. Come sento la vita, nonna, éd. de Claudia Gasparini et de Naila Clerici, Rome, Délégation du Québec, s.d.
Payment, Claire, Perles de sagesse amérindienne, Montréal / Paris, Mediaspaul, 2010.
Sioui, Georges E., Pour une histoire amérindienne de l’Amérique, Québec / Paris, Les Presses de l’Université Laval / L’Harmattan, 1999.
St-Amand, Isabelle, « Discours critiques pour l’étude de la littérature autochtone dans l’espace francophone du Québec », Studies in Canadian Literature / Études en littérature canadienne, 35, 2 (2010), p. 30-52.
Trigger, Bruce G., Préface, in Georges E. Sioui, Pour une histoire amérindienne de l’Amérique, Québec / Paris, Les Presses de l’Université Laval / L’Harmattan, 1999, p. xi-xviii.